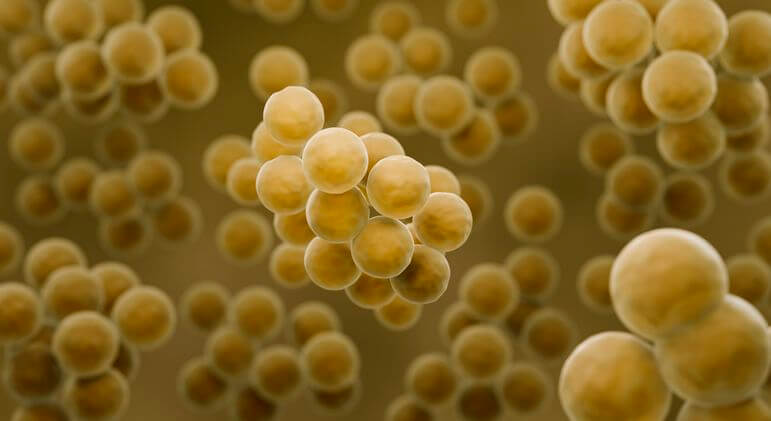
Staphylococcus aureus le plus souvent en cause.Artur Plawgo / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Les infections ostéoarticulaires sont potentiellement graves, difficiles à traiter car les antibiotiques diffusent mal dans l’os.
Elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital (choc septique) et fonctionnel.
Il faut savoir évoquer le diagnostic devant une symptomatologie frustre.
En cas de suspicion d’infection ostéoarticulaire, il ne faut surtout pas prescrire d’antibiotiques à l’aveugle, avant les prélèvements, ce qui risquerait de « décapiter » l’infection et d’induire des résistances.
En revanche, il est nécessaire de demander en urgence un avis spécialisé auprès du centre des maladies infectieuses référent, qui dictera les modalités de prise en charge.
La VIDAL Reco sur la conduite à tenir devant ces infections vient d’être actualisée.
Les infections ostéoarticulaires (IOA) bactériennes sont soit articulaires (arthrites), soit osseuses (ostéites), soit mixtes (ostéoarthrites).
Elles sont définies comme aiguës lorsqu'elles évoluent depuis moins de 4 semaines, chroniques au-delà.
Ces infections sont dues à la pénétration intra-osseuse ou intra-articulaire de bactéries par voie hématogène via la membrane synoviale, par inoculation directe (traumatisme, geste chirurgical, infiltration) ou plus rarement par contiguïté.
Chez l’enfant indemne de pathologie sous-jacente, elles sont le plus souvent communautaires, consécutives à une bactériémie, plus rarement liées à une inoculation directe.
L'incidence des arthrites aiguës sur articulation native (sans matériel prothétique) varie de 4 à 29/100 000 patients-années, avec un pic avant l'âge de 2 ans, et une augmentation progressive après 50 ans.
La mono-arthrite est la forme la plus fréquente, le genou étant touché dans 50 % des cas, ensuite les épaules et les poignets, mais toutes les articulations peuvent être atteintes.
Staphylococcus aureus est la bactérie la plus fréquemment en cause (50 % des cas d'arthrites documentées, chez l'enfant comme chez l'adulte) puis, chez l'adulte Streptococcus spp, et chez l'enfant de 6 mois à 4 ans Kingella kingae.
Chez l’adulte, un bacille à Gram négatif est en cause dans 15 à 20 % des cas.
Quand doit-on y penser ?
À la phase aiguë, le tableau clinique est le plus souvent évocateur : articulation douloureuse, tuméfiée, rouge et chaude ; un épanchement est fréquent. S’y associent des signes généraux (fièvre, frissons) plus ou moins marqués, et un syndrome inflammatoire biologique.
Dans les formes chroniques, qui peuvent ne se manifester que par des douleurs avec ou sans fièvre, parfois des fistules, les anomalies biologiques sont parfois absentes (cf. Encadré 1).
Il faut donc :
- toujours être « méfiant » et notamment savoir évoquer le diagnostic chez un patient ayant une lombalgie fébrile, qui peut révéler une infection disco-vertébrale (anciennement dénommée spondylodiscite), qui est l’ostéomyélite hématogène la plus fréquente après l’âge de 50 ans. L’atteinte du rachis thoracique ou cervical est plus rare.
- être également toujours attentif chez les patients porteurs de matériel prothétique (cf. Encadré 2), car une infection ostéoarticulaire peut se révéler très à distance de la pose de la prothèse. Une vigilance particulière doit donc être portée lors de la survenue d’une tuméfaction, y compris plusieurs années après la pose.
Tout patient avec un tableau clinique d’IOA doit être hospitalisé rapidement, si possible dans un service de maladies infectieuses, pour confirmer le diagnostic, réaliser le bilan dont les prélèvements ostéoarticulaires de qualité, et initier le traitement, lequel peut être médico-chirurgical.
Imagerie et confirmation microbiologique
L'imagerie est indispensable. La radiographie standard est d’indication large (en dehors des atteintes disco-vertébrales). Si l'échographie permet de mettre en évidence un épanchement (utile dans les arthrites septiques), c’est l'IRM qui est l’examen le plus performant.
Toute suspicion d’infection ostéoarticulaire doit faire prendre contact en urgence avec un service de maladies infectieuses, qui indiquera la conduite à tenir, proposera un rendez-vous rapide, ou une hospitalisation, selon le contexte.
La confirmation bactériologique est indispensable, car seul l'isolement de l'agent infectieux par ponction articulaire, voire abord osseux, avec étude des sensibilités, permet l’identification de l’agent bactérien en cause, l’étude de sa sensibilité aux antibiotiques et donc un traitement adapté. Il faut absolument proscrire toute antibiothérapie intempestive avant prélèvements, sauf situation d’extrême urgence (choc septique), car elle risque de « décapiter » l’infection et de favoriser les résistances.
Les prélèvements (aspiration à la seringue, ponction articulaire, biopsie chirurgicale) doivent être réalisés par des mains expertes.
Les hémocultures sont systématiques.
Une antibiothérapie probabiliste après prélèvement
La VIDAL Reco détaille les modalités de l’antibiothérapie (qui nécessite un avis spécialisé auprès d’un infectiologue), d’abord probabiliste et commencée après les prélèvements microbiologiques, puis adaptée secondairement à leurs résultats. Elle peut être complétée par des soins locaux (ponction, lavage, drainage…).
La surveillance, étroite, est clinique (fièvre, douleurs), biologique (évolution d'un syndrome inflammatoire et suivi bactériologique) et éventuellement par imagerie.
Il s’agit d’un traitement de plusieurs semaines, commencé généralement par voie intraveineuse, à forte posologie, puis relayé par voie orale.
Un antibiotique inadapté ou administré sur une durée trop courte expose au risque de rechute ou de passage à la chronicité.
La bonne observance est ainsi essentielle et le médecin traitant participe activement à la gestion des éventuels effets secondaires.
Une endocardite est systématiquement recherchée en cas d'infection à cocci à Gram positif. Son traitement ne modifie pas la durée de l’antibiothérapie de l'IOA.
D’après un entretien avec le Pr Christian Chidiac, professeur émérite des universités, Maladies infectieuses et tropicales, Université Claude-Bernard Lyon 1.
|
Les infections ostéoarticulaires chroniques surviennent chez l’adulte et compliquent le plus souvent une infection ancienne, ou une infection aiguë dont le traitement n’a pas été optimal (retrait de matériel infecté impossible, par exemple). Il existe des facteurs favorisants, locaux (corps étrangers, séquestre osseux…), généraux (diabète, immunodépression…) et bactériens (protéines d’adhérence, antibiorésistance…). Les principales bactéries en cause sont : Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa et Streptococcus spp. La prise en charge est médicochirurgicale. Lorsque le traitement chirurgical est impossible, une antibiothérapie suppressive est prescrite à vie. Dans tous les cas, il est nécessaire de demander un avis spécialisé dans l’un des neuf centres de référence coordinateurs des infections ostéoarticulaires complexes (CRIOAc), qui va orienter le traitement. |
|
Les IOA complexes regroupent les infections sur prothèse, matériel d’ostéosynthèse, post-traumatiques, certaines infections osseuses chroniques et infections des parties molles. Le taux d’infection sur matériel prothétique se situe entre 1 et 2 %. Ces IOA sont volontiers médiatisées et peuvent faire l’objet de graves contentieux. La prise en charge médicochirurgicale relève d’équipes multidisciplinaires et des centres référents (centres de référence des infections ostéoarticulaires complexes (CRIOAc). |

 6 minutes
6 minutes Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire


Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.